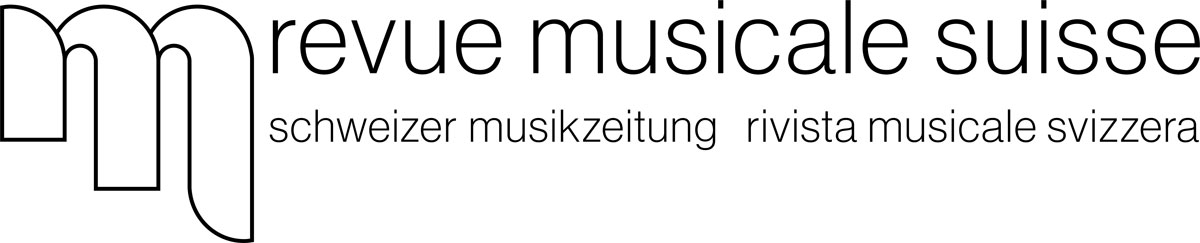Hèctor Parra crée une œuvre de mémoire
Son opéra « Justice » a marqué la saison 23/24 du Grand Théâtre de Genève, où il a été présenté en création mondiale. En redonnant vie à un drame oublié, le compositeur catalan Hèctor Parra signe une œuvre forte et secoue l’univers lyrique.

La base de ce nouvel opéra est un accident survenu en République Démocratique du Congo en février 2019, dans lequel est impliquée une multinationale suisse implantée dans ce pays. Un camion-citerne transportant de l’acide sulfurique a percuté un bus sur une route du Katanga, une région très riche en minerais et autres matières premières, indispensables à l’avancée technologique du monde moderne. Le bilan est tragique avec plus de vingt morts et de nombreux blessés graves atteints par les substances toxiques, qui polluent aussi la rivière et les terres environnantes de Kabwe.
Hèctor Parra, dans un monde envahi par une actualité macabre, pourquoi ce sujet vous a-t-il particulièrement intéressé ?
Aviel Kahn, le directeur du Grand Théâtre de Genève m’avait commandé un opéra autour de la Croix-Rouge et de la naissance de l’humanitarisme moderne à Genève au 19e siècle. Il nous a donc réuni moi et le cinéaste et metteur en scène suisse Milo Rau qui avait en tête un autre projet auquel j’ai tout de suite adhéré, car j’y voyais plusieurs choses fondamentales. Milo est tourné vers le théâtre documentaire et politiquement engagé. Depuis 2013, il travaille au Congo sur la question des génocides et des guerres économiques, ce qui a donné lieu à son Tribunal sur le Congo. Cet opéra est donc né de son amour pour le Congo et de ce tribunal. Quand il m’a proposé ce sujet et le scénario original, j’avais, de mon côté, déjà composé des pièces en rapport avec l’Afrique de l’Ouest. L’Afrique pour moi est, sans doute, une région de prédilection. Je n’y avais pas encore été physiquement avant cet opéra, mais ça m’intéressait beaucoup, y compris au niveau musical. Les sources de notre humanité sont africaines. Si on veut se confronter aux sources mêmes de notre propre histoire, il faut donc aller en Afrique. Dans cet opéra, on parle d’un accident provoqué par la négligence et les abus extrêmes que tous les pouvoirs économiques du monde causent dans cette vaste région. L’injustice et la brutalité de l’événement m’ont immédiatement touché. On parle d’un noyau de population qui est en fait allégorique de toute l’Afrique. Aujourd’hui, trente millions de personnes souffrent de ces abus dans cette région. Cela continue dans une espèce de post-colonialisme extractif d’un cynisme inimaginable, sans aucun humanitarisme. Il nous tenait à cœur de rendre justice d’une manière ou d’une autre à ces victimes de l’accident de 2019. Pour toutes ces raisons, nous avons pensé que c’était très important de faire un opéra sur ce sujet qui relève de l’universel.
La distribution vocale comporte deux voix de soprano – Axelle Fanyo et Lauren Michelle –, deux mezzo-sopranos – Katarina Bradić et Idunnu Münch –, un contre-ténor – Serge Kakudji –, un ténor – Peter Tantsits –, et deux barytons-basses – Willard White et Simon Shibambu. Comment s’est faite la sélection de ces voix ?
On les a cherchées et nous avons fait des réunions en zoom. J’ai écouté des enregistrements et pris bonne connaissance de leurs voix pour pouvoir écrire pour chacune d’entre elles. Par exemple, Katarina Bradić, dans le rôle du conducteur du camion, est une mezzo-soprano très colorature, baroque avec une voix articulée d’une grande beauté. Je lui ai fait un rôle sur mesure, où elle peut exprimer toutes ses émotions, toute sa vocalité. En même temps, l’écrivain congolais Fiston Mwanza Mujila développait le livret d’après le scénario élaboré par Milo. Pour le compositeur, le livret et le rapport au librettiste sont vitaux. Tous mes librettistes sont devenus de grands amis. C’est un rapport à vie. C’est comme un jumelage. L’opéra est l’une des formes artistiques où le travail en équipe est très fort. Il faut une cohésion totale, mais aussi une ouverture d’esprit, car parfois il faut céder à ses propres idées et s’adapter, avoir une plasticité mentale pour pouvoir comprendre l’autre et exprimer de la meilleure façon ce que veut l’autre. Même si dans une œuvre lyrique, le compositeur est une figure centrale, je ne veux pas imposer toutes mes idées préconçues. Au contraire, avec cet opéra je souhaitais évoluer en tant que compositeur et en tant qu’être humain. Et le climax fut le voyage que j’ai fait au Katanga.
La tradition musicale congolaise, en particulier la culture luba, a profondément infusé et guidé votre processus créatif. Quel a été le principal défi auquel vous avez dû faire face durant ce voyage ?
Le principal défi a été d’absorber vraiment la culture du Katanga et du Kasaï, ainsi que les cultures millénaires de ce pays, d’appréhender cette terre lointaine que je ne connaissais pas. Mais aussi de connaître en profondeur les personnes et les personnages qui nous ont inspirés pour cet opéra, et de les exprimer de façon belle, sincère et profonde. Car je me suis rendu dans la région du Katanga surtout pour rencontrer personnellement les survivants de l’accident, documenter leurs paroles, et pouvoir ainsi travailler et échanger avec Milo et l’équipe de création. La culture luba, ancestrale de 400 ans, est emprunte d’harmonie et de féminité, elle est d’une richesse et d’une créativité extraordinaire ! L’art luba a été une source d’inspiration fondamentale pour la composition de Justice. Les thèmes sont fondés sur le répertoire traditionnel luba, hemba, lulua, kaonde, et lunda du sud du pays. J’ai transcrit et écouté pendant des mois un ensemble de 150 pièces traditionnelles de la région, dont certaines ont plus de 200 ans. J’ai essayé en quelque sorte de me convertir moi-même en un habitant de la région. En tout cas, j’ai commencé à aimer, et quand on connaît on aime ! J’ai pu saisir le rapport profond que même un compositeur européen, catalan peut avoir avec cette culture-là. J’ai donc composé cet opéra absolument entouré de connaissances, de lectures et de livres. Pour moi cela a tissé tout un monde imaginaire créé aussi par le fantasme de ne pas avoir été au Congo jusqu’à la fin du projet. Ces rencontres avec les victimes m’ont permis de percevoir leurs émotions, leur forteresse, leur dignité, et de recalibrer encore un peu plus les émotions lyriques que je voulais exprimer à travers la partition. J’ai modifié donc quelques éléments dans l’écriture, comme des petites orchestrations, des petits contours vocaux… Par exemple, ça a été capital pour moi d’écouter la voix de Yowali Binti, une maman victime, avec sa fille, de l’accident, la façon dont elle s’exprimait en swahili, et ce qu’elle voulait dire, comment elle bougeait, quelle est son impulsion vitale… Je l’ai ensuite exprimé aux artistes lyriques. Pour moi, c’était un peu un « transducteur » de cette énergie congolaise à l’opéra en Europe.
La partition privilégie les voix féminines pour traduire l’émotion, et l’écriture orchestrale est d’une extrême complexité rythmique, vous y associez une large percussion qui joue des instruments à lamelles – le vibraphone, le xylophone ou le marimba, ainsi qu’un piano à queue et une harpe. Quelle a été la réception de la partition par les chanteurs et l’Orchestre de la Suisse Romande ?
Ils l’ont tout de suite intégrée. Ils ont beaucoup aimé l’écriture et le lyrisme. La communication entre les chanteurs et moi-même a été naturelle, immédiate, et très profonde. Sinon ça ne marcherait pas. Aussi, dans la culture luba, les femmes jouent un rôle décisif dans les prises de décision. C’est pour cela que dans Justice, la grande majorité des passages les plus émouvants et lyriques sont chantés par des voix féminines. Je voulais parvenir à un langage lyrique actualisé qui mette en jeu les problèmes de notre époque, à travers un lyrisme très expressif qui embrasse les émotions les plus variées. Dans l’écriture, il y a des sonorités stridentes, métalliques qui ne sont pas typiques de l’orchestre symphonique. J’ai donc métamorphosé l’orchestre pour le rapprocher de la musique traditionnelle katangaise. En ce qui concerne les rythmes, je me suis inspiré des danses cérémonielles luba. Serge et Fiston m’ont confié avoir senti pleinement une musique qui leur est chère mais complètement transformée. Pour les musiciens de l’OSR, sous la direction de Titus Engel, c’est une musique nouvelle, très exigeante, et qui n’est pas classique. Mais je sens qu’ils aiment jouer cette musique. Il y a beaucoup de passages d’une virtuosité extrême, c’est une musique de la savane tropicale, avec beaucoup de peaux, des bois, du métal. Les instruments ont effectivement été construits avec le métal, qui est à la base de cette culture luba aussi acoustique. De telle façon que j’ai rempli l’orchestre de métal, avec des cuivres, mais aussi des cloches, des sanzas, des enclumes…
Parmi les éléments qui font de cet opéra une œuvre novatrice, il y a aussi la présence sur scène du guitariste congolais Kojack Kossakamvwe dans un rôle clé, dont les improvisations virtuoses sont captivantes…
Oui, Kojack est un guitariste de grande renommée dans sa région. Je ne lui ai pas composé une seule note, car il ne peut pas lire la musique. Il s’est donc préparé au projet en écoutant l’orchestre, et je lui ai créé des moments de guitare dans la partition, entre chaque acte. Ses improvisations mêlent le funk et la musique traditionnelle de Kinshasa. Cela crée des moments de détente que l’on recherchait, pour apporter un côté moins brutal… Il joue sa propre composition en accord avec la mienne et en accord avec le drame. En rapprochant cette tragédie à la musique populaire congolaise moderne, il apporte toute une autre dimension qui justement fait ce que je ne pourrai jamais faire, car je ne suis pas un musicien populaire congolais. C’est donc une dimension qu’on ne voulait pas manquer. Et c’est pour cela que Kojack fait partie des trois narrateurs de l’histoire, avec le librettiste Fiston Mujila et le contre-ténor Serge Kakudji. Tous trois tissent les vrais rapports congolais les plus profonds.
Fiston Mwanza Mujila nous a d’ailleurs révélé l’importance pour lui de « faire acte de témoignage » sur scène et avoir eu le sentiment d’accomplir « un devoir de mémoire » à l’écriture du livret. Car il y a, selon lui, une culture de l’amnésie au Congo. Cet opéra peut-il vaincre cette culture de l’amnésie, réparer une iniquité et lutter contre l’oubli ?
Pour avoir une justice, il faut briser l’amnésie ! Espérons que cet opéra puisse le faire, car il fait parler la presse et le monde entier. Il permet en tout cas de stimuler une certaine prise de conscience et une sensibilisation, aussi à travers la campagne internationale « Justice pour Kabwe ». En Occident, l’opéra est l’événement culturel qui rassemble tous les arts. Et pour la première fois au cœur de cet événement, des voix africaines oubliées s’expriment et elles ont une importance cruciale. Nous donnons une voix opératique aux victimes réelles du système économique mondial. Il faut savoir aussi que toute personne originaire du Katanga, comme Fiston ou Serge, est d’une certaine manière victime collatérale, car elle a des proches ou des connaissances qui ont travaillé dans les mines. Pour Fiston, l’écriture du livret a aussi été vécue comme un exercice de deuil.
L’accident et ses conséquences sont restitués sur écran à travers une vidéo conçue par Moritz von Dungen. C’est un opéra qui joue beaucoup sur le rapport entre le réel et la fiction…
Sur la scène il n’y a aucune victime réelle, tous sont des artistes, acteurs ou chanteurs, ils sont des allégories de victimes réelles de l’accident. Serge Kakudji incarne Milambo Kayamba, un commerçant qui a perdu ses deux jambes dans l’accident, mais il se représente aussi lui-même et joue donc deux personnages. Le personnage d’Axelle Fanyo est aussi un mélange de deux femmes que nous avons rencontrées au Katanga et qui apparaissent dans la vidéo. Les biographies qui défilent sur un écran sont, quant à elles, toutes réelles. On est toujours sur un fil entre la fiction, c’est-à-dire l’opéra, les personnages qui sont des sortes d’archétypes, et les véritables victimes que toute l’équipe est partie rencontrer au Congo.
C’est nouveau dans le monde de l’opéra d’intégrer le théâtre documentaire…
C’est déjà arrivé, mais pas sur ce sujet et d’une façon tellement poussée. Ici, on a vraiment rejoint les forces de deux dimensions qui ne se rencontrent presque jamais. Le théâtre de Milo Rau n’a presque jamais rencontré l’opéra. De mon côté, c’est la première fois que je travaille avec un directeur tel que Milo, et avec un librettiste congolais. Fiston est l’un des écrivains et poètes les plus avant-gardistes de l’Afrique. L’écriture du livret lui a permis de renégocier avec une certaine authenticité. Comme il le dit, le défi pour lui a été de joindre la sincérité à la pudeur vis-à-vis des victimes. Il exprime ce qui s’est passé dans son pays, avec un langage novateur. Pour moi c’était donc vital de collaborer avec lui. Nous faisons chanter un langage pleinement congolais. Et ça c’est très spécial. Cet opéra s’est fait de manière très collaborative entre le metteur en scène, le compositeur et le librettiste. C’est un projet de collaboration européenne et africaine.
Un simulacre de procès n’a abouti à rien si ce n’est à une compensation dérisoire pour les victimes de l’accident. Cet opéra est une pierre lancée contre les pouvoirs économiques, politiques et judiciaires. Pensez-vous que cela pourra aboutir à une réouverture d’un procès ?
C’est vraiment conscient. Pour moi le chant lyrique n’est pas un chant décoratif, ce n’est pas une esthétisation d’un acte de parole, ça va au-delà. Le lyrisme selon moi c’est justement le contraire, c’est la recherche d’un atavique, au plus profond de nous. Le lyrisme inhérent à l’être humain est, dans ce cas, exprimé par une voix opératique. Mais dans d’autres cultures, le lyrisme peut être exprimé par d’autres types de voix. En Afrique, on a plutôt une voix tendue, sans vibrato. Certaines critiques peuvent être émises par rapport au fait qu’un lyrisme extrême pourrait trahir la violence, la brutalité, ou nous déconnecter. Mais après ce que j’ai perçu au Congo, je ressens franchement le contraire. Quand on a chanté les petits bouts d’arias aux victimes de l’accident, ils se sentaient soulagés…
L’opéra doit-il nécessairement traiter des problématiques d’aujourd’hui ? Un créateur doit-il avoir une responsabilité politique ?
Je me suis convaincu que oui. Je dirais plutôt une responsabilité éthique. Mais une responsabilité politique sur le terrain peut-être aussi, car on en a besoin. Si on ne parle pas de ces gens-là concrètement et qu’on ne les nomme pas, alors cela ne sert à rien, car c’est trop vague et trop éloigné du fait réel. Je suis pour aller jusqu’au bout de l’intervention dans la politique avec l’art. Milo Rau m’en a vraiment convaincu. Je l’ai déjà fait dans d’autres pièces. Orgia dénonce le consumérisme atroce. Dans Les Bienveillantes, je dénonce l’impulsion génocidaire de l’être humain. Et dans Justice, c’est le néo-colonialisme en Afrique et la manière dont les multinationales s’y prennent pour le prolonger dans le temps qui sont dénoncés. La musique et la création peuvent servir à dénoncer cela avec la beauté de la création, à éveiller les consciences, à donner une voix aux gens qui ont perdu leur voix. Et dans ce cas, on donne la voix la plus belle, celle de la voix lyrique extrême. Pour moi, cette « beauté » artistique est l’arme la plus puissante contre la brutalité, cette beauté entre guillemets, car parfois ça peut être aussi un éclatement terrible de l’orchestre ou des bruits absolus. Les pouvoirs n’aiment pas du tout que les artistes s’y mélangent. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que l’artisanat, c’est-à-dire la qualité du travail intrinsèquement artistique, est aussi vital pour générer un résultat d’autant plus fort.